- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Le 8 janvier 1910, Paris est le théâtre d’un crime qui allait secouer l'opinion publique et marquer l’histoire judiciaire française. Jean-Jacques Liabeuf, un cordonnier de 31 ans, assassine un policier dans un acte de vengeance, convaincu d'avoir été victime d'une erreur judiciaire.
Jean-Jacques Liabeuf était un ouvrier cordonnier vivant à Paris. En 1909, il est arrêté et condamné pour proxénétisme après avoir été accusé d’être impliqué dans la prostitution. Cette accusation provient d’un lien qu’il entretenait avec une femme suspectée d'exercer la prostitution. Liabeuf, de son côté, a toujours nié cette accusation, affirmant qu’il n’avait jamais été proxénète et que son procès avait été une injustice. Condamné à un an de prison, il ressort de cet épisode animé par un profond ressentiment à l’égard de la police, qu’il estime responsable de sa condamnation injuste.
Sa colère et son désir de vengeance contre ceux qu’il tenait pour responsables grandissent pendant sa détention. Lorsqu’il sort de prison, il élabore un plan pour se venger de la police parisienne.
Le crime
Le 8 janvier 1910, Liabeuf, armé de plusieurs pistolets et portant des brassards cloutés, se met en quête de policiers. En croisant une patrouille dans le quartier de la Bastille, il attaque deux agents, blessant gravement l'un d'eux. Une fusillade éclate dans les rues de Paris, provoquant la panique parmi les passants. Les policiers finissent par riposter, mais l’attaque est si soudaine et violente que l’un des agents, le policier Célestin Deray, succombe à ses blessures.
Après l’altercation, Liabeuf est capturé et arrêté par les forces de l’ordre. Lors de son arrestation, il ne cache pas ses motivations, déclarant qu'il avait agi pour se venger de ce qu'il considérait comme une condamnation injuste et une persécution par la police.
Le procès
Le procès de Jean-Jacques Liabeuf s’ouvre peu de temps après les faits, et il devient l’un des plus médiatisés de l’époque. Sa défense est simple : il affirme qu'il n'avait jamais été proxénète et qu’il avait été condamné à tort. Il admet avoir voulu se venger de la police, qu’il tenait pour responsable de sa condamnation et de sa souffrance.
Le jury et les juges sont confrontés à une question délicate : d'un côté, ils sont face à un homme qui avait indéniablement prémédité un meurtre ; de l’autre, la situation de Liabeuf soulève un certain débat autour de la question des erreurs judiciaires et du traitement réservé aux individus jugés pour proxénétisme, une accusation souvent floue à l'époque.
Malgré une défense passionnée, Jean-Jacques Liabeuf est reconnu coupable de l’assassinat du policier Célestin Deray. La violence de son acte et la volonté délibérée de tuer des policiers mènent à une sentence sévère : il est condamné à mort.
L'exécution et les répercussions
Malgré les appels à la clémence et une certaine sympathie dans l’opinion publique, notamment parmi ceux qui voyaient en Liabeuf un homme poussé au désespoir par l'injustice, le président de la République refuse de lui accorder la grâce. Le 2 juillet 1910, Jean-Jacques Liabeuf est guillotiné à la prison de la Santé à Paris.
Son exécution provoque une vague d'émotion et de débats en France. L'affaire Liabeuf devient le symbole des tensions entre la police, la justice, et les classes populaires de Paris. Beaucoup voyaient en lui une victime du système, tandis que d'autres le considéraient comme un criminel qui avait froidement pris la vie d’un homme.
Impact
L’histoire de Jean-Jacques Liabeuf a marqué la France par la violence de l'acte, mais aussi par la réflexion qu’elle a suscité sur les erreurs judiciaires, le ressentiment populaire contre la police, et la justice pénale. Elle est souvent évoquée comme un exemple des conséquences dramatiques de l’injustice perçue et du désir de vengeance.
Célestin Deray : un serviteur de la Nation
Célestin Deray, né en décembre 1861 à Gouhelans, dans le Doubs, a consacré une grande partie de sa vie à servir son pays. Après dix ans passés dans l'armée, il a été nommé gardien de la paix à la préfecture de police de Paris le 16 octobre 1893. Il a été affecté au 4e arrondissement de la capitale, où il a exercé ses fonctions avec dévouement.
Marié et père de deux enfants, Célestin Deray était reconnu pour son engagement et son courage. Son nom figure sur le monument aux morts de la Cour du 19 Août, cité à l'ordre de la Nation, honorant ainsi sa mémoire et son sacrifice.
Célestin Deray a été inhumé trois jours après sa mort au cimetière du Montparnasse, dans la 27e division, où il repose en paix.
 |
| Jean-Jacques Liabeuf |
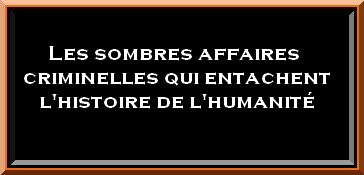
Commentaires
Enregistrer un commentaire